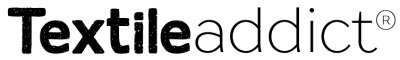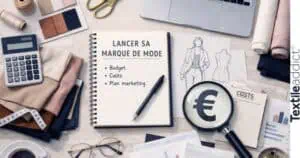| Mis à jour 09/2025 |
Photo Sportswear : Suzanne Lenglen – Wimbledon, 19 juin 1924 – Daily Mail
Le sportswear illustre à merveille la façon dont deux univers, a priori très éloignés, peuvent s’interconnecter. Mélange de genres, ce courant vestimentaire s’est imposé en souplesse, au point qu’il est désormais impossible d’envisager la mode sans lui !
Son histoire reflète des changements socioculturels majeurs : évolution du rapport au corps, émancipation des femmes, importance attachée au bien-être et à l’épanouissement personnel… Aujourd’hui, mode et sport s’enrichissent mutuellement et entretiennent une relation fusionnelle, avec un même objectif : concilier élégance et confort.
Comment le vêtement sportif s’est-il immiscé dans la mode et dans notre vie quotidienne ? À vos marques, prêts, partez… à la découverte de l’histoire du sportswear !
Qu’est-ce que le sportswear ?
Le sportswear a aujourd’hui plusieurs définitions. En français, cet anglicisme apparu entre-deux-guerres correspond à « tenue de sport« . Il qualifiait au départ des vêtements chics et confortables réservés à un usage sportif.
Durant le XXe siècle, les vêtements sportifs ont « glissé » des vestiaires de gymnase aux garde-robes. Cela fait maintenant plusieurs décennies que les vêtements sportswear se portent au quotidien, en dehors de tout exercice physique. Le terme a pris un sens beaucoup plus global. Le sportswear est devenu un style, un phénomène de mode qui englobe désormais une large famille de vêtements et accessoires décontractés : jogging, baskets, hoodie, casquette, sweatshirt, t-shirt, legging, doudoune…
Bien avant le vêtement de sport
À l’origine, point de vêtement dans le sport. Durant l’Antiquité, les athlètes grecs étaient nus, à l’image du Discobole de Myron, représenté dans le plus simple appareil. Les gymnastes ne s’embarrassaient pas encore de contraintes vestimentaires. Ils ignoraient probablement que leur anatomie traverserait les époques en restant un idéal esthétique, synonyme de jeunesse et de vitalité.
Bien avant que l’humanité ne découvre massivement les joies du sport, des logos et des maillots colorés, les chevaliers arboraient les couleurs de leur seigneur lors des tournois. Leurs tenues répondaient déjà au besoin d’identifier facilement un champion sur le terrain ! Une tradition médiévale a d’ailleurs laissé sa trace dans le vocabulaire du sport et des jeux : en cas de victoire, le chevalier se voyait offrir une manche du vêtement de la dame pour laquelle il avait combattu, « remportant la manche », au sens propre du terme.
Les premiers à se préoccuper réellement de leur confort ont été les joueurs de paume (l’ancêtre du tennis), qui n’hésitaient pas à délaisser leurs vêtements usuel pour enfiler des vêtements blancs plus légers pendant leurs parties.
Le vêtement de sport, une histoire d’élégance et de confort
Les débuts du sport, mens sana in corpore sano
Éclairée par le Siècle des Lumières, puis par le courant hygiéniste, la « bonne société » du début du XIXe siècle pratique certaines activités physiques (archerie, équitation, escrime…) Les médecins encouragent d’ailleurs à faire de la gymnastique pour être en meilleure forme. L’exercice physique gagne en popularité, sans révolutionner pour autant les habitudes vestimentaires. Si l’on change de tenue pour être (un peu) plus à l’aise et éviter de salir ses vêtements usuels, c’est toujours en privilégiant l’élégance. Bien que l’on préfère les matières confortables et faciles à entretenir (coton, laine), on s’exerce en tenue et chaussures de ville.
L’élite, adepte du fair-play et des sports individuels
Durant tout le XIXe siècle, la bourgeoisie européenne se plaît à pratiquer des sports individuels comme le tennis, le golf ou l’équitation. Ces activités réservées à l’élite s’envisagent comme un divertissement et un marqueur social, sans recherche de performance. L’essentiel est d’avoir de l’allure et l’esprit fair-play, mais le confort n’est toujours pas au coeur des préoccupations. Les costumes de circonstance restent raffinés et ne présentent pas de différence notable par rapport aux habits courants. Le corsage et la jupe seront la norme admise chez les femmes jusqu’au début du XXe siècle, et ce en toute occasion. En revanche, les cavalières – qui chevauchent en amazone par décence – voient apparaître les premières culottes pantalons, discrètement portées sous les jupes.
L’avènement des sports collectifs
Le développement des sports d’équipe (cricket, rugby, football…) venus tout droit d’Angleterre, ainsi que la codification de nombreuses disciplines sportives récentes amènent progressivement à attacher plus d’importance au confort. Non seulement pour être à l’aise, mais aussi pour réaliser de meilleures performances et entretenir l’esprit d’équipe. Cette évolution du sport, mais aussi des mentalités débouche sur plusieurs innovations : création du maillot sportif en maille jersey extensible, apparition de pointes ou crampons sur les semelles des chaussures de foot et d’athlétisme…
Sport et progrès
À l’aube du XXe siècle, le sport est en plein essor. Les premiers Jeux olympiques modernes se déroulent en 1896, le milieu sportif se professionnalise, on organise de plus en plus de compétitions… On commence à apprécier les joies de la baignade et de la natation, en corset et costume de laine couvrant pour les dames et maillot une-pièce ou short pour les hommes.
Plusieurs inventions auront marqué ce siècle et favorisé l’émergence de nouveaux loisirs. Ainsi, la bicyclette, l’automobile, mais aussi le développement des chemins de fers vers les stations balnéaires et les montagnes ont largement contribué au développement de nouvelles disciplines sportives, incitant rapidement à gagner en confort et en liberté de mouvement.
Jeanne Lanvin (1867-1946) – Dessin à la gouache Collection «Sport Hiver 1928» © Patrimoine Lanvin // Neyret – Maillot de bain deux-pièces Années 1930 Maille de laine jacquard, jersey de laine, boucles métalliques © Les Arts Décoratifs / Christophe Dellière // Jean Patou – Muguette Bulher, croquis d’un modèle de tennis France, 1934-1937 Crayon et gouache sur papier © Les Arts Décoratifs / Christophe Dellière – source : exposition Mode et Sport, d’un podium à l’autre
La naissance du sportswear
Les Années folles… de sport
Le sportswear apparaît vers 1920 (le terme apparaît en 1928 dans la presse), alors que le milieu de la mode et du sport se rapprochent. Dans ces Années folles, le monde va plus vite et plus loin, découvrant les sports d’hiver, mais aussi les sports mécaniques (course automobile, aviation…) Entre-deux-guerres, la société voue un culte à la jeunesse et les activités physiques sont en vogue. Les premiers vêtements réellement dédiés au sport sont développés : le survêtement permet de se réchauffer avant et après l’effort, René Lacoste invente le célèbre polo à manches courtes en maille piquée, Jean Patou raccourcit la robe de tennis pour une célèbre championne française… Les articles enthousiastes consacrés aux activités sportives et aux équipements foisonnent dans la presse mode de l’époque.
Une bouffée d’air frais dans la mode, un pas en avant pour les femmes
Alors que certains créent des tenues élégantes et confortables spécifiquement adaptées à chaque discipline, la mode devient beaucoup plus décontractée chez les grands couturiers, profondément imprégnés de cette ambiance sportive. Un vent de confort et de liberté souffle sur les créations : les coupes deviennent plus fluides, les matières s’allègent, les jupes raccourcissent, au grand bonheur de la nouvelle génération, séduite par l’allure chic et nonchalante de ces vêtements « sportswear » imaginés par les grands noms de l’époque : Jeanne Lanvin, Gabrielle Chanel, Jean Patou, Hermès ou Elsa Schiaparelli… Tout au long du XXe siècle, mode et sport ne cesseront d’interagir et de s’inspirer mutuellement.
Ces changements d’habitudes vestimentaires contribuent à la libération des moeurs et à l’émancipation des femmes. Celles-ci peuvent désormais porter un bloomer (jupe-culotte bouffante) à vélo sans choquer les esprits, et les premières championnes de natation n’hésitent pas à enfiler des maillots de bain une pièce. En public, on privilégie encore le pyjama de plage pour se baigner : le bikini n’apparaîtra qu’en 1946.
Déposez gratuitement votre projet sur Textile Addict,Besoin des conseils d'un spécialiste textile ?
recevez des devis qualifiés et sélectionnez le freelance idéal.
Dans les années 1980, le sport a déjà pris ses marques dans une société de consommation bien établie qui prône le dynamisme et la performance. Les corps libérés se dévoilent sans complexes, mais le besoin de sculpter sa silhouette s’affirme. Il faut être mince, en forme et le montrer, ce qui explique le succès de l’aérobic et des salles de fitness venus des USA.
Paradoxalement, il n’est plus nécessaire de faire du sport pour porter des vêtements de sport. Peu à peu, le sportswear devient une attitude, le style t-shirt/jogging/basket étant accessible à tous, sportifs ou non. Il se porte en ville, dans la rue, et fait désormais partie intégrante de la mode, inspirant les défilés de haute couture mais aussi les « contre-cultures » hip hop ou streetwear…

Entre sport et mode, une relation fusionnelle
Cela fait plus d’un siècle que la mode et le sport entretiennent un lien « gagnant-gagnant », renforcé par la popularisation du sportswear.
La mode s’invite régulièrement sur le terrain pour habiller les sportifs, que ce soit à l’occasion des Jeux olympiques (Balmain, Courrèges, Issey Miyake, Lanvin…) ou de grandes compétitions.
Mais les années 1990 et 2000 ont vu se multiplier les interactions entre le milieu de la mode et celui du sport. La création de la ligne Y-3 P par Adidas et Yohji Yamamoto en 2003 a marqué le point de départ de nombreuses collaborations entre maisons de luxe et équipementiers sportifs. Par ailleurs, les athlètes de haut niveau, de plus en plus soucieux de leur image publique, recherchent des vêtements performants au design étudié. Ils sont devenus des icônes inspirantes pour le public et pour les créateurs. Ce statut leur permet de solliciter de grands couturiers pour créer leurs tenues et de passer d’un podium à l’autre en défilant pour les plus grandes maisons.
Evolution des vêtements de sport par décennie
| Décennie | Matériaux principaux | Styles phares | Marques phares |
|---|---|---|---|
| Années 1920 | Coton, laine, jersey extensible, débuts des tissus synthétiques comme le nylon. | Tenues décontractées, jupes raccourcies pour le tennis, polo à manches courtes, maillots de bain une-pièce, emphasis sur le confort et l’élégance sportive. | Coco Chanel, Jean Patou, René Lacoste, Elsa Schiaparelli. |
| Années 1950 | Nylon, polyester émergents, laine et coton synthétisés pour plus de durabilité et légèreté. | Sportswear casual intégrant des éléments athlétiques, shorts athlétiques, windbreakers, anoraks, rise du style athleisure précoce. | Adidas, Puma, Levi’s (pour les jeans sportifs), Converse. |
| Années 1980 | Synthétiques avancés comme le spandex (Lycra), polyester, nylon stretch pour la flexibilité. | Tenues aérobic flashy, leggings, tracksuits, hoodies, couleurs vives et logos proéminents, fusion avec la culture pop et hip-hop. | Nike, Reebok, Adidas, Fila, Puma, Champion. |
| Années 2020 | Matériaux recyclés, biodégradables, tissus techniques durables (polyester recyclé, coton organique, bambou), fibres intelligentes. | Athleisure hybride, designs inclusifs et unisexes, collaborations luxury-sport, focus sur la durabilité et la performance multi-usage. | Nike, Adidas, Patagonia, Lululemon, Gucci x Adidas, Off-White x Nike. |
Focus sur le maillot de bain sportif
L’histoire de la mode balnéaire en France révèle une fascinante évolution marquée par des transformations sociétales, techniques et esthétiques. Tout commence au XIXe siècle, lorsque les théories hygiénistes vantent les bienfaits des bains de mer, entraînant la création de stations comme Dieppe et Biarritz, popularisée par l’impératrice Eugénie, puis la Côte d’Azur, initialement prisée par les Britanniques pour l’hiver avant de s’ouvrir à l’été dans les années 1920 grâce aux élites américaines. Le succès croissant impose des réglementations municipales pour préserver la moralité, transformant la plage en un lieu de sociabilité démocratisée, où le barbotage initial évolue vers une natation sportive, d’abord pratiquée par les hommes puis par les femmes, accompagnée de costumes de plus en plus adaptés.
Les premiers costumes féminins, vers 1875, composés d’une blouse et d’un pantalon en sergé de laine, lin ou coton, garantissent la décence avec corset baleiné, bonnet, bas et espadrilles, rendant la baignade inconfortable ; au tournant du XXe siècle, ils se raccourcissent en combinaisons ceinturées, allégeant les accessoires et dévoilant bras et mollets, inspirés par les exploits de nageuses comme Rosa Frauendorfer et Annette Kellerman.
Dans les années 1920, la Méditerranée éclipse les côtes atlantiques, attirant une clientèle sportive pratiquant le crawl ; les maillots une-pièce ajustés en maille souple deviennent unisexes, avec teintes vives et bonnets de caoutchouc, favorisant le bronzage symbole de santé, bien que certains médecins alertent sur ses excès, marquant un regard plus libre sur le corps féminin préludant au deux-pièces. Pour les hommes, dès la seconde moitié du XIXe siècle, les tenues moulantes en jersey de laine ou coton léger s’adaptent à la natation, évoluant dans les années 1930 vers des slips courts torse nu pour les bains de soleil.
La presse féminine, comme Femina dès 1901, modifie le regard sur l’exercice physique féminin, promouvant des tenues sportives ; après la Première Guerre, des succursales de couture en stations balnéaires boostent la mode, tandis que les années 1930, via Vogue et Harper’s Bazaar, incitent à une silhouette mince et hâlée.
Focus sur Jacques Heim, qui transforme l’activité familiale en haute couture dès 1930, avec succursales à Biarritz et Cannes, inaugurant un département jeunes filles et lançant le paréo tahitien en 1934. Après 1950, Madame Grès excelle dans des ensembles de plage minimalistes en jersey plissé, consacrée « Reine de la plage » en 1971 ; Miu Miu, depuis 1993, revisite les tenues post-guerre avec imprimés seventies, évoquant des scandales mode comme Prada en 1996. Cette évolution reflète une dénudation progressive, du corps voilé au libéré, influencée par société, santé et couture.

Focus sur les vêtements de sports d’hiver
Les vêtements de sports d’hiver évolueront depuis les prémices du XIXe siècle jusqu’aux tendances contemporaines, mêlant innovation textile, adaptation aux conditions extrêmes et influences culturelles. Avant 1900, aucune tenue spécifique n’existait : les femmes portaient des robes et paletots en drap épais bordés de fourrure, tandis que les hommes optaient pour des costumes en laine avec knickerbockers, des bandes étanches protégeant les mollets de la neige, reflétant une utilisation pragmatique des fibres naturelles comme la laine mérinos pour la chaleur.
Avec l’essor des stations alpines au tournant du XXe siècle, stimulé par le développement des chemins de fer, les coupes s’adaptent : les femmes adoptent jupes courtes, jerseys épais et brodequins, tandis que les hommes conservent des costumes trois-pièces avec des teintes contrastées pour se démarquer sur la neige, un style promu par des revues comme Femina en 1906.
Les années 1920 marquent l’essor du ski récréatif, avec des ensembles unisexes en gabardine ou sergé de laine, comprenant vareuses militaires et pantalons norvégiens, suivis dans les années 1930 par le pantalon fuseau d’Armand Allard, conçu pour Émile Allais à Megève, et la combinaison de Maurice Och à Saint-Moritz, favorisant performance et androgynie. Les équipementiers, comme Tunmer avec son modèle « Davos » en 1911, et les maisons de couture, telles Hermès avec des costumes réversibles ou Jean Patou avec son « Coin des Sports » en 1925, innovent, tandis que la presse (revues L’Art et la Mode ou Jardin des Modes) amplifie l’engouement en illustrant des tenues élégantes.
Après la Seconde Guerre mondiale, André Ledoux, skieur et couturier, crée en 1945 des lignes chics pour les JO de 1948, utilisant laine et nylon. Les années 1950 introduisent l’Élastiss (laine-nylon) d’Allard pour les JO d’Oslo 1952, suivies par les doudounes de Moncler dans les 1960-1970.
Aujourd’hui, des designers comme Walter Van Beirendonck revisitent bombers et après-ski avec des imprimés provocants et des matières techniques, tandis que le marché mondial, valorisé à 2,65 milliards USD en 2023 selon Grand View Research, croît à un rythme de 7,3 % annuel jusqu’en 2030, porté par des fibres recyclées et une demande durable. Ce patrimoine textile, ancré dans les Alpes françaises, illustre une fusion entre tradition artisanale et modernité, influencée par des pionniers et des tendances globales.

Les tendances actuelles du sportswear en 2025
En 2025, le sportswear connaît une évolution accélérée, portée par une croissance qui surpasse celle du marché de la mode globale de 5 à 6 points de pourcentage dans des régions clés comme la Chine, selon les analyses du secteur. L’essor des matériaux durables domine les tendances, avec une adoption massive de tissus recyclés, biodégradables et à faible impact environnemental, tels que le coton organique, le bambou, le chanvre et les polyesters recyclés, répondant à une demande croissante pour des produits éco-responsables qui allient performance et respect de l’environnement.
Parallèlement, les collaborations entre maisons de luxe et marques sportives se multiplient, comme l’emblématique Gucci x Adidas ou des partenariats récents impliquant des influenceurs et des advocates de la durabilité, intégrant des aesthetics rétro avec des technologies modernes pour créer des pièces hybrides alliant style urbain et fonctionnalité.
L’intégration de technologies intelligentes, comme les vêtements connectés pour le suivi de performance, et une emphase sur l’inclusivité (tailles adaptées et designs unisexes) renforcent cette dynamique, transformant le sportswear en un pilier de la mode quotidienne, tout en promouvant des pratiques durables et innovantes.
Aujourd’hui, les frontières entre ces deux univers se sont plus qu’estompées. Mode et sport s’entremêlent en permanence dans une dynamique sans cesse renouvelée, partageant les mêmes exigences sur le plan de l’esthétique et du confort, et les mêmes valeurs d’excellence. Et tout semble démontrer que le sportswear, fruit de leur relation enrichissante, a encore un bel avenir devant lui !
À lire :